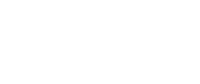Des chercheurs et chercheuses de l’IPBS coordonnent ou sont partenaires de 10 projets financés par l’Agence nationale de la recherche (ANR)

Les champs électriques pulsés de courte durée et de haute intensité sont connus pour induire la formation de structures conductrices dans les membranes lipidiques cellulaires ou artificielles, un phénomène appelé électroporation (EP). Dès les années 1980, il a été démontré que l’EP permettait de transférer de l’ADN plasmidique dans les cellules. Avec l’essor des stratégies de vaccination à base d’ADN, l’électroporation de vaccins ADN (DVEP) s’impose comme une approche prometteuse pour les thérapies de nouvelle génération. Toutefois, ses bases physiques restent mal comprises.
Le projet DEVIN (Modélisation numérique de l’électroporation pour la vaccination ADN), auquel Marie-Pierre Rols est associée, vise à combler cette lacune en développant des modèles physiques et numériques robustes de la DVEP, étroitement intégrés à des données expérimentales. L’objectif est de construire un cadre multiphysique et multiéchelle complet de modélisation de l’entrée de l’ADN, depuis des vésicules unilamellaires géantes (GUVs), modèles biophysiques simplifiés de la membrane cellulaire, jusqu’à des sphéroïdes multicellulaires complexes.
À terme, DEVIN ambitionne de concevoir et valider des protocoles d’électroporation optimisés numériquement pour améliorer l’efficacité et la fiabilité du transfert d’ADN à visée thérapeutique.

Le projet MabsCAMP (Signalisation par l’adénosine monophosphate cyclique dans la biologie de Mycobacterium abscessus et comme cible thérapeutique), coordonné par Christophe Guilhot et auquel Céline Cougoule est associée, explore le rôle de la signalisation par l’AMP cyclique (cAMP) chez M. abscessus, un pathogène émergent hautement résistant aux antibiotiques, responsable d’infections pulmonaires sévères chez les patients atteints de mucoviscidose. M. abscessus s’adapte aux environnements hostiles de l’hôte, ce qui favorise une tolérance phénotypique aux antibiotiques et accroît le risque d’échec thérapeutique et de résistance. Si le cAMP régule l’adaptation au stress et la formation de biofilms chez de nombreuses bactéries, son rôle chez M. abscessus reste inconnu. Ce projet vise à (i) identifier les gènes et voies régulés par le cAMP, (ii) évaluer l’impact de sa modulation sur des traits clés de M. abscessus comme la formation de biofilms et la tolérance aux antibiotiques, (iii) décrypter les mécanismes moléculaires sous-jacents, et (iv) tester le potentiel thérapeutique du ciblage du métabolisme du cAMP. En combinant génétique, transcriptomique, métabolomique et modèles d’infection (macrophages, organoïdes bronchiques de patients mucoviscidosiques, poisson-zèbre), le projet vise à révéler de nouveaux mécanismes de pathogénicité et de tolérance. Il rassemble quatre équipes expertes en France et au Royaume-Uni autour d’une recherche fondamentale innovante contre l’antibiorésistance.

Le projet KIFMITO (Interactome de KIF2C à la jonction microtubule–kinétochore en mitose), auquel Florence Larminat est associée, vise à comprendre comment la dépolymérase des microtubules KIF2C régule la ségrégation correcte des chromosomes lors de la mitose. KIF2C joue un rôle essentiel dans la correction des erreurs d’attachement entre microtubules et kinétochores, évitant ainsi l’instabilité chromosomique et l’aneuploïdie, caractéristiques fréquentes des cellules cancéreuses. Son activité est finement régulée par phosphorylation, mais les mécanismes moléculaires par lesquels ces modifications contrôlent les interactions et fonctions de KIF2C restent mal compris. Ce projet a pour objectif de cartographier l’interactome mitotique de KIF2C, de caractériser ses condensats dépendants de la phosphorylation, et d’étudier comment ces complexes influencent l’organisation du fuseau mitotique, les attachements microtubulaires, ainsi que le point de contrôle du fuseau.

Le projet ALARMIN-ALLERGY (Rôles, régulation et coopération des alarmines IL-33 et TL1A dans l’initiation de l’inflammation allergique des voies respiratoires), coordonné par Jean-Philippe Girard, vise à élucider les mécanismes précoces à l’origine de l’inflammation allergique des voies respiratoires, en se concentrant sur les cytokines épithéliales IL-33 et TL1A. Ces « alarmines » sont rapidement libérées en cas de lésion tissulaire et activent la réponse immunitaire en stimulant les cellules lymphoïdes innées de type 2 (ILC2), entraînant la production de cytokines inflammatoires telles que l’IL-5, l’IL-9 et l’IL-13. L’équipe a récemment découvert que TL1A, à l’instar d’IL-33, agit comme une alarmines dans le poumon et coopère avec IL-33 pour induire un phénotype transitoire « ILC9 » lors des premières phases de la réponse allergique. Grâce à des modèles murins et à une approche multidisciplinaire, incluant des lignées transgéniques, l’immunologie, la protéomique et la biologie moléculaire, le projet analysera la régulation d’IL-33 et TL1A, ainsi que leur contribution à l’initiation de l’allergie. Fort de plus de 20 ans d’expertise sur IL-33 et de solides collaborations, le projet devrait fournir des avancées majeures et identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques pour moduler l’inflammation induite par IL-33/TL1A, avec des implications directes pour l’asthme et d’autres maladies allergiques.

Le projet CyT-Bone, coordonné par Christel Vérollet et auquel Frédéric Lagarrigue est associé, étudie comment deux protéines, RIAM et Lamellipodin (LPD), régulent la formation et l’activité des ostéoclastes (OCLs), des cellules responsables de la résorption osseuse, dont le dysfonctionnement contribue à des maladies telles que l’ostéoporose et la parodontite. À l’aide de nouveaux modèles murins transgéniques et d’ostéoclastes humains, l’équipe analysera les rôles distincts de RIAM et LPD dans le remodelage du cytosquelette d’actine et l’adhésion médiée par les intégrines, lors de la fusion et de l’activité des OCLs. Le projet évaluera également les conséquences de la perturbation de ces protéines dans des modèles murins d’ostéoporose et de parodontite. En combinant imagerie avancée, transcriptomique et tests fonctionnels, ce consortium interdisciplinaire vise à révéler de nouveaux mécanismes de l’ostéoclastogenèse et à identifier des cibles thérapeutiques potentielles pour prévenir la perte osseuse pathologique.

Le projet Proteasom-Inhib (Inhibition sélective des sous-types de protéasomes 20S associés à différents régulateurs), coordonné par Julien Marcoux et auquel Étienne Meunier est associé, vise à développer une nouvelle génération, la troisième, d’inhibiteurs du protéasome, ciblant spécifiquement certains sous-types régulés par PA28, impliqués dans les maladies auto-inflammatoires. Contrairement aux inhibiteurs actuels qui ciblent le cœur catalytique du protéasome et provoquent souvent une toxicité, cette approche innovante s’attaque à l’interface entre le protéasome 20S et ses sous-unités régulatrices PA28 (PA28αβ-i20S et PA28γ-std20S), impliquées dans la présentation de l’antigène et l’inflammation. En s’appuyant sur des campagnes de criblage récentes ayant identifié des composés sélectifs, les chercheurs appliqueront une stratégie de déconstruction–reconstruction pour optimiser l’affinité et la spécificité. Les composés candidats seront testés in vitro et in cellulo pour évaluer leur impact sur la présentation antigénique et la production de cytokines, les plus prometteurs étant validés sur des cellules dérivées de patients et des modèles d’organoïdes. Des approches structurales de pointe (cryo-EM, spectrométrie de masse structurale, cristallographie aux rayons X) guideront les études de relation structure–activité (SAR). Cette stratégie de rupture ouvre la voie à des traitements plus sûrs et ciblés des maladies auto-inflammatoires, en modulant la fonction du protéasome sans inhiber globalement son activité catalytique.

Le projet INTOX (Détection immunitaire des toxines modificatrices des Rho GTPase par l’inflammasome NLRP1), auquel Étienne Meunier est associé, vise à définir le rôle de l’inflammasome humain NLRP1 dans la détection des manipulations microbiennes des cellules hôtes au cours de l’infection. En tant que première ligne de défense, les cellules épithéliales expriment spécifiquement NLRP1, suggérant une fonction spécialisée dans l’immunité innée. Les agents pathogènes détournent fréquemment des enzymes clés de l’hôte, telles que les Rho GTPases, pour échapper à la détection immunitaire. Le projet étudiera comment NLRP1 perçoit ces perturbations afin de déclencher une réponse inflammatoire. S’appuyant sur des données préliminaires solides et un consortium multidisciplinaire de microbiologistes, biochimistes et immunologistes, cette recherche vise à mieux comprendre la contribution de NLRP1 à la défense épithéliale contre les infections.

Les récentes avancées en omiques ont révélé que de petits cadres ouverts de lecture (smORFs) peuvent produire des milliers de microprotéines (<100 acides aminés), constituant une source encore inexploitée de molécules impliquées dans le développement et la signalisation cellulaire. Le projet Sex_And_SmORFs, dont Bertrand Fabre est partenaire, explore leur rôle dans la reproduction chez Drosophila, en se concentrant sur la réponse post-accouplement (PMR), un ensemble de changements comportementaux et physiologiques chez la femelle déclenchés par des signaux mâles. Nous avons identifié deux microprotéines mâles, Tic et Tac, codées par un ARNm bicistronique, comme régulateurs clés de cette réponse. À l’aide d’outils génétiques et d’imagerie avancée chez Drosophila, le projet vise à : (1) déterminer la fonction de Tic et Tac dans les organes reproducteurs mâles, (2) identifier d’autres microprotéines mâles impliquées dans la PMR, et (3) découvrir des microprotéines femelles responsables du remodelage de la spermathèque, un organe sécréteur essentiel à la fertilité. Ce projet contribuera à révéler le rôle des microprotéines comme nouveaux régulateurs de la reproduction et de la communication inter-organes, avec des implications potentielles en agronomie et santé publique via le contrôle de la fertilité des insectes.

ELECTROSCOPE, coordonné par Maxime Berg, est un projet interdisciplinaire visant à comprendre comment la signalisation bioélectrique, en particulier les potentiels de repos transmembranaires (TMRP), contribue au développement du cancer. Les TMRP reflètent la différence de charge électrique entre l’intérieur et l’extérieur des cellules et jouent un rôle clé dans la structuration des tissus à travers leurs interactions avec le microenvironnement cellulaire. Ce fragile équilibre est perturbé dans le cancer, mais sa nature complexe et multi-échelle le rend difficile à étudier. ELECTROSCOPE propose un modèle mathématique novateur considérant la distribution des TMRP comme un réseau dynamique, avec le carcinome hépatocellulaire (CHC) comme cas d’étude. Ce modèle sera alimenté par des données expérimentales issues de systèmes in vitro de complexité croissante, et intégrera l’effet de champs électriques externes utilisés dans des thérapies émergentes. Cette approche vise à révéler comment les altérations bioélectriques liées au cancer émergent de comportements cellulaires collectifs, offrant un nouveau cadre pour explorer l’initiation et la progression tumorales à différentes échelles.

Le projet SEA-iDNA (Sélection et études d’anticorps ciblant les i-motifs de l’ADN), auquel Dennis Gomez est associé, vise à développer des anticorps hautement spécifiques capables de reconnaître sélectivement les structures d’ADN i-motif (i-DNA), des conformations secondaires non canoniques, riches en cytosine, impliquées dans la régulation génique. En raison du manque actuel d’outils moléculaires fiables pour étudier les i-motifs, le projet utilisera des modèles chimiques stabilisés de ces structures pour orienter la sélection de nouveaux anticorps par phage display. Ces anticorps seront ensuite soumis à des validations rigoureuses in vitro et en cellule, afin de permettre une cartographie précise et une étude fonctionnelle des i-motifs à l’échelle du génome. Alliant des expertises en chimie bioorganique, biophysique, biologie moléculaire et cellulaire, ce projet interdisciplinaire ambitionne de fournir des outils essentiels pour faire progresser notre compréhension de la biologie des i-motifs et de leur rôle potentiel dans les maladies humaines.